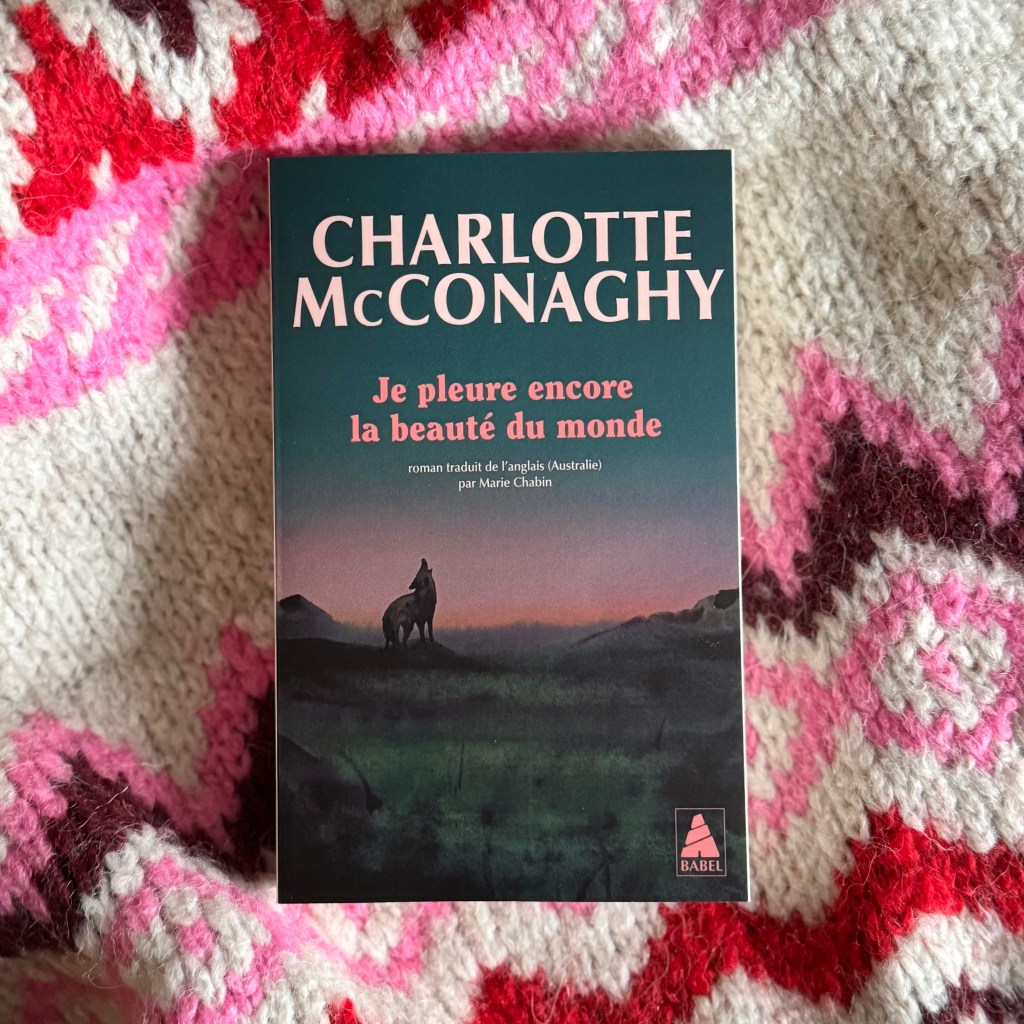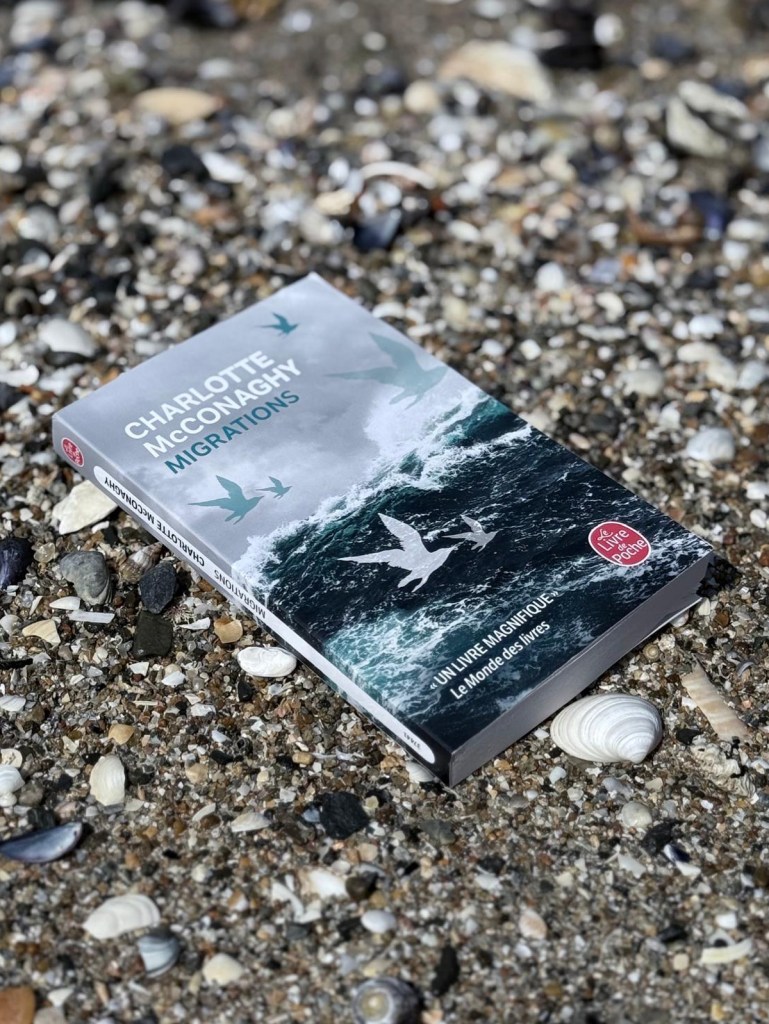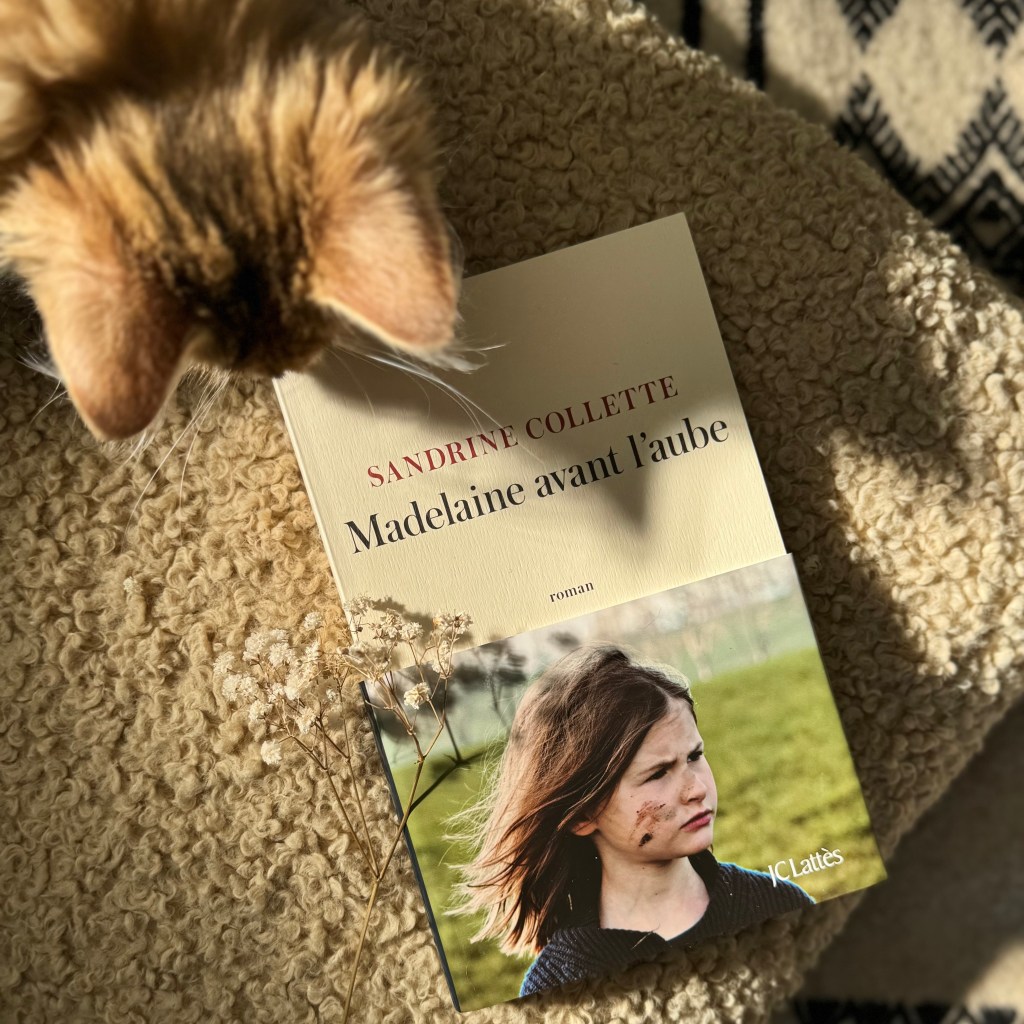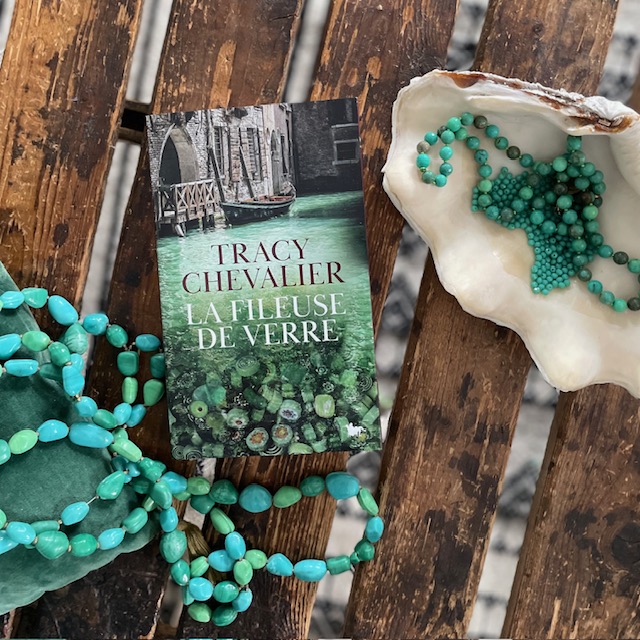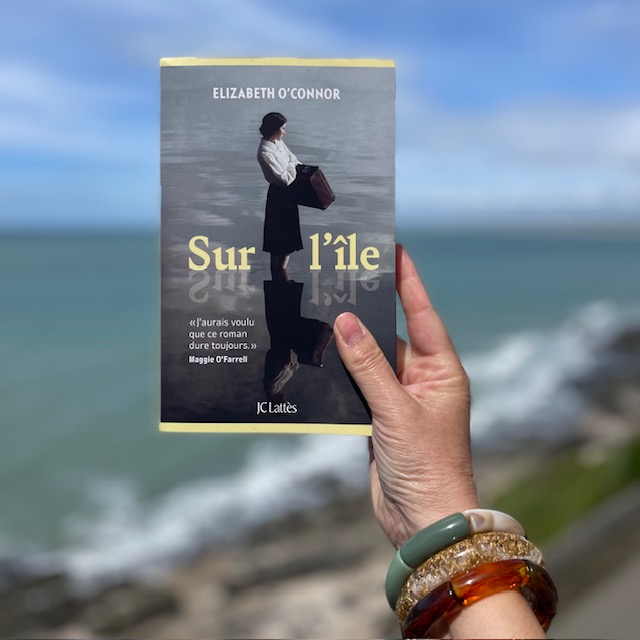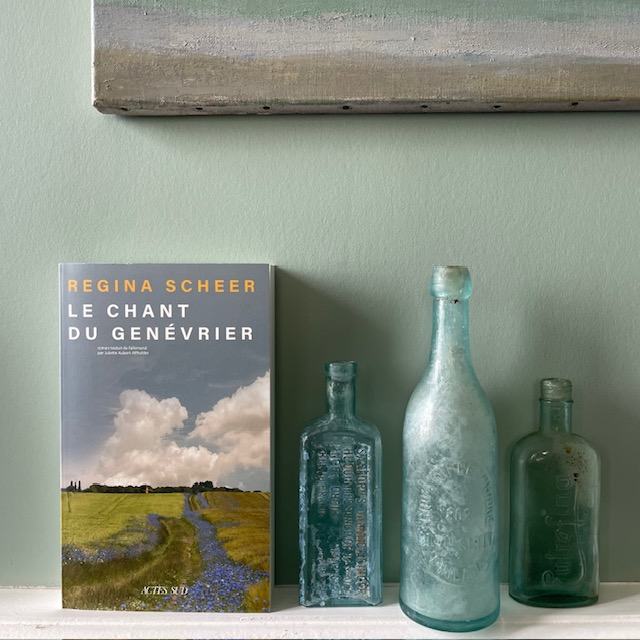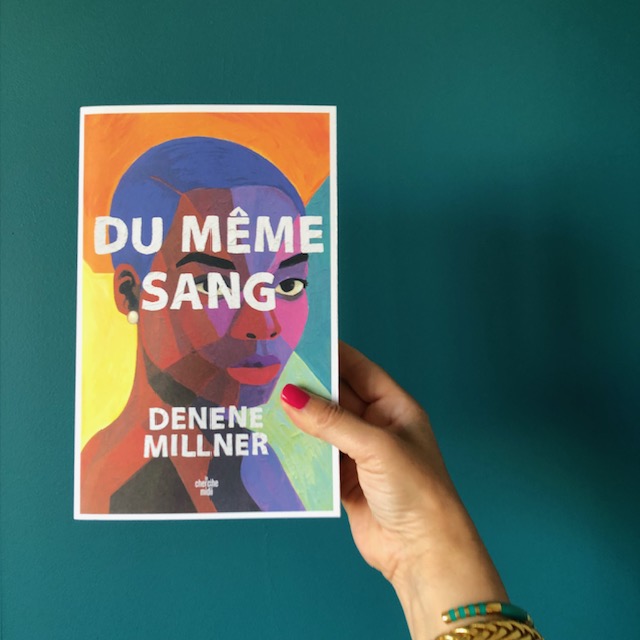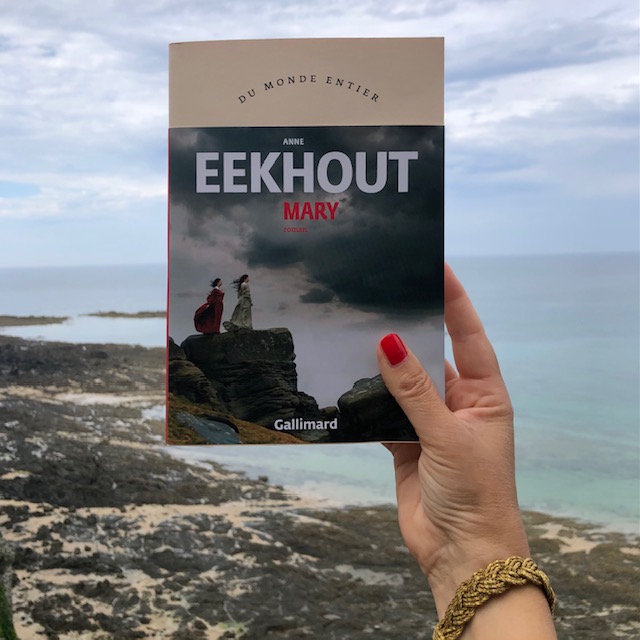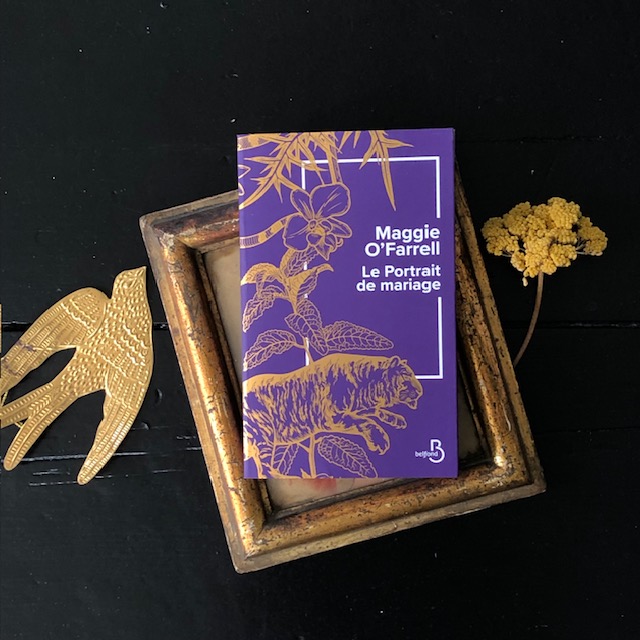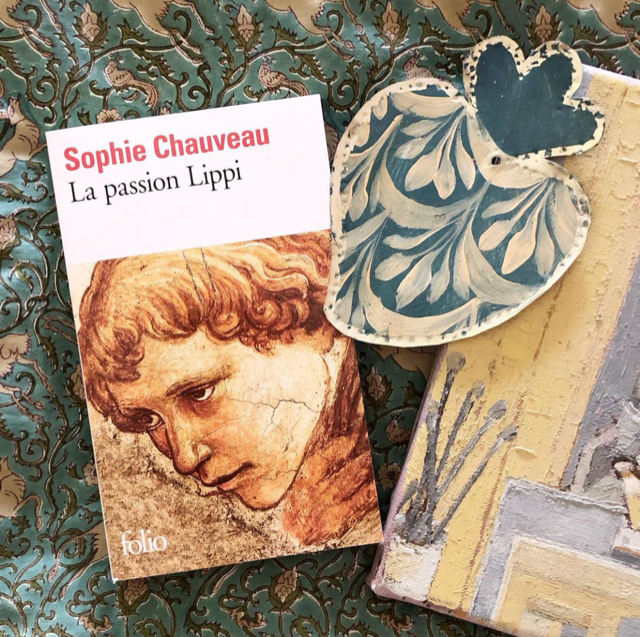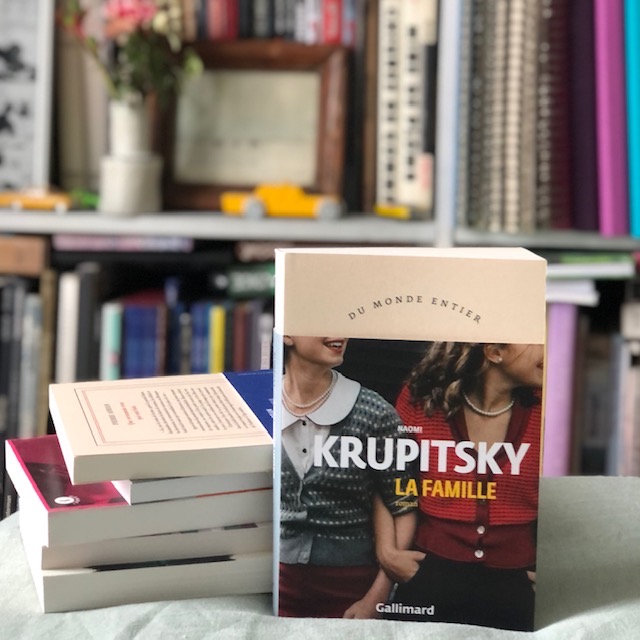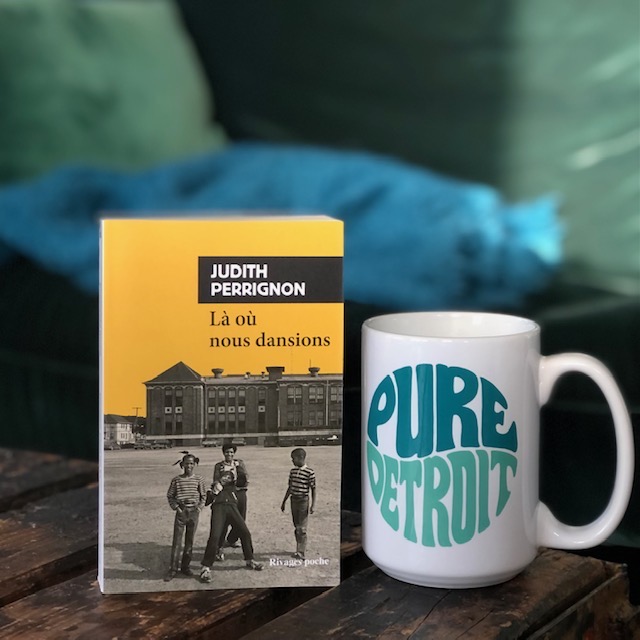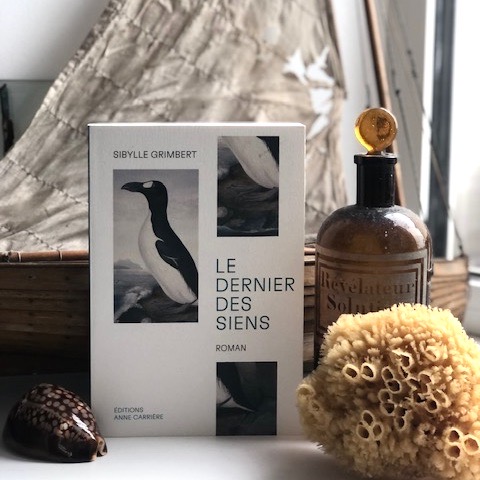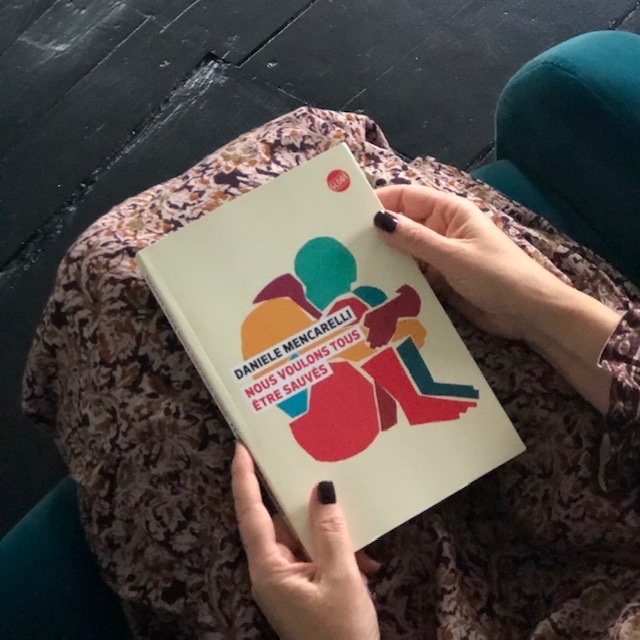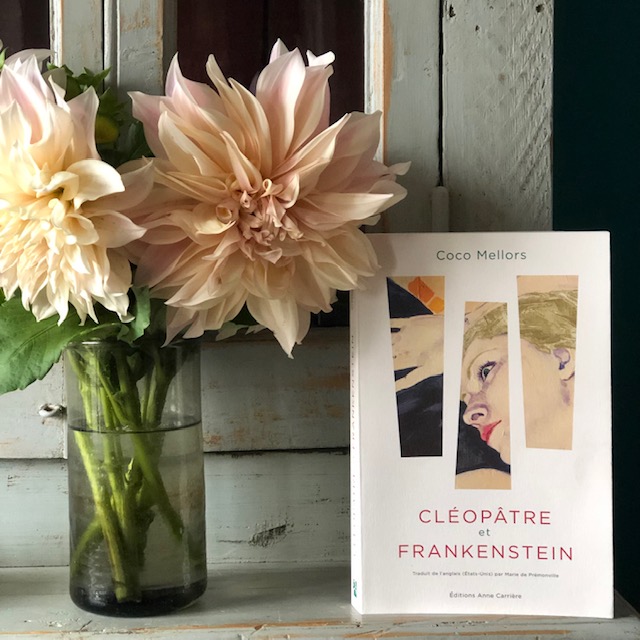Sybil Van Antwerpen est une charmante septuagénaire. Avocate, elle a mené un brillante carrière de greffière à la cour d’appel du Maryland, formant un duo de choc (voué à maintes spéculations) avec le juge Donnely, qui vient de mourir. Divorcée depuis de longues années, elle vit désormais seule dans une maison coquette d’Annapolis. Entre ses activités au club de jardinage et ses lectures, Sybil s’adonne tous ses lundis, mercredis, vendredis et samedi à lune intense correspondance.
« La correspondance est le pilier de ma vie, tandis que je n’ai exercé le droit qu’une trentaine d’années. Être greffière était mon métier ; la somme de mes lettres est ce que je suis ».
Depuis son enfance, elle envoie des lettres – cela a commencé avec des missives à sa meilleure amie, Rosalie, devenue depuis sa belle-sœur. Puis, avec le temps, elle a pris la plume pour s’adresser à quiconque motivait un courrier, à commencer par ses écrivains favoris.
Sybil est de ceux qui posent les questions ouvertement et s’intéressent sincèrement aux autres, attachant la plus grande importance à leurs réponses, sur lesquelles elle rebondit inlassablement.
Les premiers échanges épistolaires plantent l’intrigue, sans que l’on en saisisse toute la teneur – évidemment, nous débarquons dans cette volumineuse correspondance un jour de 2012, petits voyeurs que nous sommes, sans connaître quiconque et sans avoir un indice sur l’histoire de Sybil. Mais au fil des échanges avec les uns et les autres (son frère Felix, sa fille Fiona, le jeune Harry, sa belle-soeur Rosalie, la doyenne d’une université ou encore son voisin Théodore pour n’en citer que quelques uns), on en apprend bientôt davantage sur Sybil, ses douleurs, ses erreurs, ou ses regrets.
Et les évènements auxquels nous allons assister vont donner un tournant des plus surprenants à sa vie.
Lire la suite